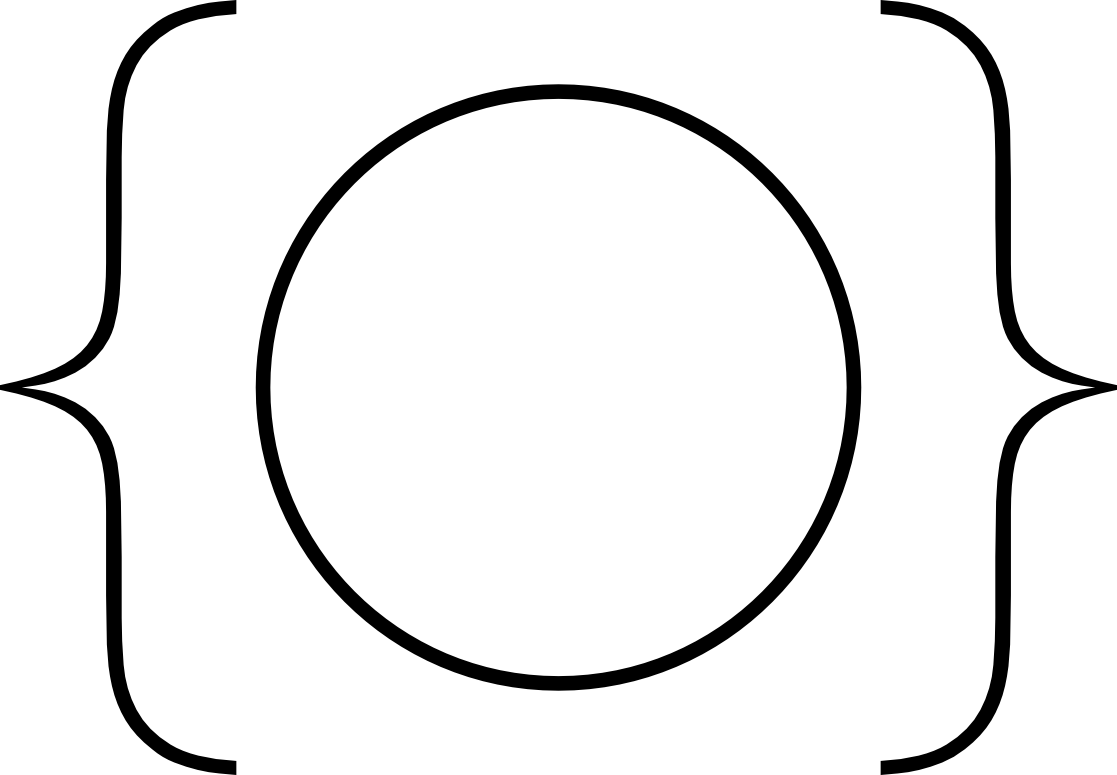Bonsoir tout le monde.
Je vous écris depuis le salon que je n’ai guère quitté depuis une semaine, avec une pensée pour ceux qui doivent affronter notre étrange époque dans des conditions moins confortables (problème de santé, patron têtu, logement exigu, conjoint mal choisi, que sais-je — courage à vous).
Rassurez-vous, je vous épargnerai mon journal de quarantaine. On va plutôt faire semblant de rien pendant quelques minutes.

Je suis récemment allé au MAC/VAL pour la première fois.
Abstraction faite du côté systématiquement incongru des Grands Projets de Revitalisation Urbaine (l’arrivée depuis le métro se fait par des rues très hostiles aux piétons, et bordées de pavillons ornés d’une quantité invraisemblable de lucarnes ; l’environnement direct du musée est complètement éventré par des travaux de voirie et ceux des futures stations de métro du Grand Paris ; tout ça donne l’impression que le MAC/VAL est une enclave, ce qui est précisément l’inverse de l’objectif affiché), abstraction faite de tout ça, donc, j’ai trouvé le bâtiment agréable, le personnel charmant et compétent, et les collections très intéressantes.
Évidemment, tout est relatif : quand on visite une exposition d’art contemporain, la proportion d’œuvres sans intérêt est nécessairement élevée. L’écrémage des années n’a pas eu lieu, il y a des œuvres inintelligibles parce qu’elles nous rebutent trop ou nous consternent, ou parce que leur forme nous est trop étrangère. Mais il y a aussi des choses formidables et inattendues, et c’est pour ça que ça vaut toujours la peine d’essayer. J’estime que je n’ai pas perdu mon temps s’il y a UN truc qui m’intéresse ou me touche pendant la visite — on peut ainsi classer les musées d’art contemporain selon leur « Tokyo Ratio », qui est le nombre d’œuvres intéressantes dans un volume équivalent à une visite du Palais de Tokyo.
En l’occurrence, il y avait au MAC/VAL trois œuvres que j’ai particulièrement appréciées.
1. Chants d’oiseau – Julien Discrit
La première faisait partie de l’exposition Le Vent se lève, qui présentait une sélection d’œuvres acquises l’année précédente par le musée et en rapport avec la nature.
C’est une série (j’adore les séries) de Julien Discrit et intitulée Chants d’oiseau. Il s’agit de sonagrammes représentant les chants de différentes espèces d’oiseaux, fixés sur le papier au moyen d’une des premières techniques photographiques, le cyanotype.

Visuellement, c’est très réussi : la couleur est magnifique (ne vous fiez pas à ma photo pourrie), et le fait d’avoir eu recours à des procédés purement analogiques rend le dessin un peu flou. Cet aspect fantomatique est d’autant plus surprenant qu’on ne rencontre d’habitude les ondes sonores que sous forme numérique.
Un ami avec qui je faisais la visite est restaurateur de photos, et il m’expliquait que les cyanotypes ont l’avantage d’être extrêmement stables : le pigment se régénère de lui-même à l’obscurité, ce qui en fait un excellent support d’archivage.
L’impression générale était donc de voir les spectres d’un monde disparu.
2. Botanische Garden (Neu) I & IV – Roman Moriceau

Exposées juste à côté, deux œuvres ont attiré mon regard, parce que j’en ai reconnu la technique : il s’agissait de sérigraphies. Elles étaient tout à fait à mon goût car réalisées en une seule couleur, à partir de photos tramées, ce qui est ma technique favorite.
Mais l’œuvre est bien plus riche que je ne l’avais pensé au premier abord.
Les œuvres de la série Botanische Garden (Neu) résultent d’une succession d’opérations. Roman Moriceau photographie d’abord les serres de Meise, en Belgique. Dans cet immense jardin botanique, héritier de l’Europe coloniale, des dizaines de milliers d’espèces sont présentées par variété et non par origine géographique. Elles fabriquent une idée de nature sauvage et exotisme plus qu’elles ne montrent des environnements cohérents. Roman Moriceau réalise ensuite des photomontages à partir de ses vues pour densifier les paysages, encore plus artificiels. Les images sont ensuite imprimées à la colle, et de la poussière de cuivre est dispersée à la surface, fixant l’image et occasionnant des effets de miroitement et de clair-obscur.
Le choix de la poudre de cuivre pour matérialiser le tirage ajoute une dimension supplémentaire : l’image va rapidement s’oxyder et se dégrader, sans qu’on puisse rien y faire, comme une réponse aux cyanotypes voisins.
Quand j’ai appris la sérigraphie, l’autre personne qui suivait le stage avec moi était un peintre décorateur. Il voulait notamment sérigraphier de la colle pour simplifier un peu son travail de dorure à la feuille. Il avait travaillé trois jours avec le formateur pour y parvenir. Pendant ce temps, je travaillais sur des gestes et des techniques extrêmement basiques, c’était curieux de voir en même temps les rudiments d’une technique et une application pointue, la base et le cas limite.

J’ai aussi pensé aux œuvres d’Oscar Muñoz, qui pousse la technique de la sérigraphie dans des directions incroyables (à distance sur des rideaux de douche pour donner l’illusion d’une présence, à la surface d’un miroir d’eau, au silicone transparent sur un miroir d’acier, j’en passe).
3. 8m² Loneliness – Brognon Rollin

Enfin, l’exposition temporaire (que nous étions venus voir à l’origine) se terminait par une installation à la fois glaçante et sublime.
Un espace de 8m² est délimité par trois cloisons, la quatrième est ouverte. Cet espace a la taille et la forme d’une cellule de la prison où les artistes avaient effectué une résidence. Il y a une horloge sur le mur du fond. Lorsqu’on pénètre dans l’espace de la cellule, l’horloge s’arrête. Quand on en sort, ses aiguilles se remettent à tourner à toute vitesse pour rattraper le temps perdu.
Voilà.
À mercredi prochain !
M.
⌾⌾⌾
⌾⌾⌾
ABSOLUMENT TOUT paraît un mercredi sur deux, avec chaque fois trois trucs intéressants.
Pour recevoir les futures livraisons, n’hésitez pas à vous inscrire
Et si ça vous a plu et que vous en redemandez, abonnez-vous sur Patreon !