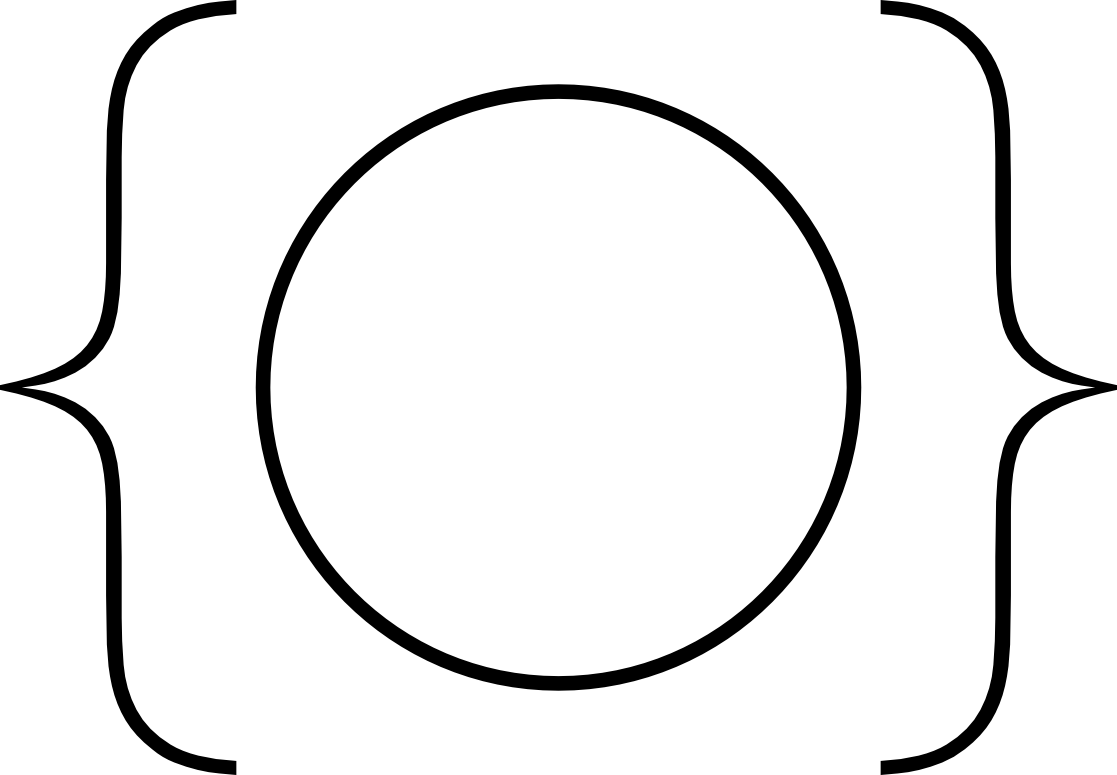Bonsoir tout le monde.
Cette semaine, on va parler de livres, de films, de plantes et de peinture.
1. L’asphyxie
La semaine dernière sur France Culture, j’ai entendu un entretien avec le peintre Thomas Lévy-Lasne, que je vous invite vivement à écouter parce que c’était passionnant, drôle et enthousiasmant.
Allez-y, hein, je vous attends. On n’est pas pressés.
C’est bon ? Alors on reprend.
Pendant l’émission, Thomas Lévy-Lasne raconte notamment que la peinture n’était guère en vogue du temps où il était étudiant aux Beaux-arts, au début des années 2000, mais que ça n’a pas empêché une génération de peintres d’apparaître et de travailler. Lorsqu’il était pensionnaire à la villa Médicis, en 2018, il a donc organisé une conférence avec l’historienne de l’art Isabelle de Maison Rouge, sobrement intitulée Vitalité de la peinture contemporaine, la scène française, et qui présente 125 peintres en un peu moins de deux heures (!).
Sur 125, j’en connaissais 3, je crois, dont un parce qu’une amie m’en avait parlé il y a quelques années. Évidemment c’est impossible de digérer réellement des centaines de tableaux affichés quelques secondes chacun sur le malheureux écran de mon iPad, mais l’exercice n’est pas sans mérite pour autant : il oblige les intervenants à être synthétiques, et du point de vue du spectateur, le rythme très soutenu a quelque chose d’hypnotique :
Quelques impressions : bien peu de choses correspondent à l’idée qu’on se fait de la peinture contemporaine — peu d’ironie facile, pratiquement pas de cradingue ou de « mon fils de 5 ans pourrait faire pareil ». Le figuratif est très majoritaire, et surtout l’ensemble m’a paru très accessible, esthétiquement plaisant même en surface.
La conférence n’est pas uniquement un marathon de présentation de tableaux. Pour souffler un peu, on voit aussi des artistes au travail dans leur atelier (mention spéciale à Marion Bataillard, qui peint d’après nature, alors qu’il est apparemment devenu plus courant de réaliser la composition dans Photoshop), ainsi que quatre peintres présents lors de la conférence et qui expliquent un peu plus en détail leur travail (j’ai adoré l’intervention de Maude Maris sur la représentation du volume).
(Globalement, j’ai trouvé tous les artistes interrogés intéressants et suspicieusement photogéniques, et je ne sais pas si c’est mon regard qui les nimbe d’une aura de mystère, ou si c’est un pré-requis pour devenir artiste)
Un PDF reprenant tous les tableaux montrés est disponible ici, et ça fait du bien de s’y replonger après avoir vu la vidéo — pour regarder de plus près les tableaux qui nous ont accroché l’œil, et pour donner une seconde chance aux autres.
⌾⌾⌾
Hier matin, j’étais dans le XIe arrondissement et j’avais une heure de libre : je n’avais donc plus aucune excuse pour ne pas aller voir l’exposition de Thomas Lévy-Lasne (intitulée L’Asphyxie).
Une quinzaine de toiles sont présentées : des fusains au rez-de-chaussée, et des huiles à l’étage.
(vous me pardonnerez si je dis des sottises ou des platitudes, j’ai à peu près perdu contact avec l’art contemporain depuis quinze ans, et même avant ça je n’en ai jamais eu une approche très construite, simplement ça appartenait à ma panoplie de petit provincial débarqué à la capitale que d’aller régulièrement au Palais de Tokyo)
J’ai adoré les fusains très denses par lesquels s’ouvre l’exposition, avec un grain qui rappelle des artefacts de compression JPEG et/ou les images qui me viennent quand j’essaie de m’endormir.
En haut, les deux tableaux les plus frappants sont respectivement intitulés Bord de mer et Au biodôme, et tous deux représentent un monde étonnamment familier, où la nature est devenue un panorama qu’on regarde derrière une rambarde pour tâcher d’avoir une vague idée de comment c’était.

[Thomas Lévy-Lasne, Au Biodôme, 2019]
Ils paraissent peints d’après une photo, mais si j’ai bien compris, le peintre part en fait d’une composition réalisée à l’ordinateur à partir de fragments de photographies piochées ici et là. Ces tableaux ont quelque chose d’un peu glaçant parce qu’on comprend immédiatement ce dont il est question.
Pour cette exposition-là, j'ai essayé d'être un peu "désanthropocentré", c'est à dire ne pas m'intéresser forcément au point de vue humain. Pourquoi pas prendre le point de vue du monde ? Dans cette perspective-là, il y a une espèce de neutralité du monde où je le donne. Même le vieillard qui regarde la jungle, il n'est pas forcément peint et traité d'une manière plus dingue que les plantes. Il est au même niveau. Donc, lui, il fait une séparation entre le réel et lui. Mais moi, je n'en fais pas dans ma peinture.
[Thomas Lévy-Lasne : "La peinture parle du réel avec le langage du réel"]
La scénographie et les poses des spectateurs sont extrêmement familières, réelles. Il me semble que ce traitement fonctionne moins dans le tableau qui représente Auschwitz, et où on voit un couple en train de se prendre en photo — disons que ça devient un peu convenu, comme critique.
⌾⌾⌾
Les tableaux m’ont parlé le plus directement lorsqu’ils représentaient des expériences incroyablement anodines (un bal de village ; un concert dans un bar ; un bord de mer d’où s’échappent des déchets enfouis ; un champ à l’aube, après la pluie), d’autant plus que ces expériences censément banales sont subitement devenues rares ou impossibles, et en tout cas chargées de peurs et de doutes.

[Thomas Lévy-Lasne, Le champ, 2020]
Il y avait enfin quelque chose d’assez déstabilisant, et pour tout dire d’un peu sinistre à visiter la galerie seul et masqué, en compagnie d’employés absolument silencieux et immobiles derrière leur comptoir, le tout dans un climat politique dégueulasse et après avoir connu des variations de températures de 20° en quelques jours.
⌾⌾⌾
L’exposition L’Asphyxie continue à la galerie Les Filles du Calvaire jusqu’au 24 octobre. Et si vous ne pouvez pas y aller, le site de la galerie a une espèce de visite virtuelle, consultable sur écran et même, comble de l’ironie, avec un casque de VR.
2. L’homme sur le toit
Depuis le succès d’édition ahurissant de la trilogie Millenium, les traductions de polars « nordiques » se sont multipliées en France, jusqu’à obtenir leur propre rayonnage dans de nombreuses librairies. Globalement, on y trouve des tueurs extrêmement sadiques, des paysages enneigés, de l’alcoolisme fortement taxé, et des sujets de société traités à l’emporte-pièce.

[Notons la prolifération du Ø, pourtant inutilisé en suédois, pour bien se raccrocher à la tendance]
Ce n’est pas de ces auteurs-là que je voulais vous parler ce soir, mais bien de la série intitulée Le roman d’un crime de Maj Sjöwall et Per Wahlöö. Ces dix polars publiés de 1965 à 1975 mettent en scène le commissaire Beck et son équipe (Melander et sa mémoire d’éléphant, Kollberg le bon vivant idéaliste, Larsson le fils prodigue nihiliste, Rönn que tout le monde prend pour un incapable) dans un Stockholm boueux et morne, toujours en chantier, peuplé de hippies et de paumés, de pornographes et de fanatiques religieux, à rebours de l’image de paradis social-démocrate dont pouvait jouir la Suède à l’époque.
C’est d’ailleurs souvent leur réalisme social désabusé qui est mis en avant aujourd’hui lorsqu’on présente ces romans, et il me semble que c’est un brin réducteur. D’abord, les romans de Sjöwall et Wahlöö sont très drôles, souvent aux dépends d’une hiérarchie policière pompeuse et inefficace, mais aussi, de manière plus subtile, aux dépends des personnages principaux — les indices sont sous leur nez mais ils ne les voient pas, des coïncidences heureuses manquent chaque fois de se produire mais non, alors il faut en passer par un laborieux travail de police.
Ensuite, les personnages créés sont mémorables, fouillés, évoluant tous au gré des romans, prenant de l’épaisseur et des chemins inattendus. Enfin, il y a un vrai tour de force dans l’écriture, parce qu’au premier abord les romans se donnent pour un commentaire social, où l’enquête n’est qu’un prétexte et dont la solution importe finalement peu (il n’y a jamais, à la fin, de grande scène explicative, ni de séance d’auto-congratulation) ; mais en réalité, ces enquêtes sont extrêmement bien ficelées, captivantes, et ne dédaignent pas un certain classicisme — il y a un meurtre en chambre close, des tueurs en série, des cadavres à identifier, des enquêtes où le commissaire urbain découvre la campagne profonde, la totale.
⌾⌾⌾
Les aventures de Martin Beck ont tout de suite rencontré un grand succès en librairie, et elles ont connu de nombreuses adaptations en film ou en série, dès 1967 en Suède, et par la suite aux États-Unis (The Laughing Policeman), en Allemagne (Der Mann, der sich in Luft auflöste) ou aux Pays-Bas (Beck: de gesloten kamer). La version la plus récente est une série suédoise tournée à la fin des années 90.
La semaine dernière, mon excellente compagne et moi avons regardé une adaptation en film de L'Abominable Homme de Säffle, intitulée en français Un Flic sur le toit (Mannen på Taket), et sortie en 1976 :
(Désolé, je n’ai pas trouvé de bande-annonce sous-titrée)
Le film est vraiment bien, empreint d’une lassitude un peu poisseuse malgré des moments franchement burlesques, les acteurs sont nickel, il y a des enquêtes patientes et des scènes d’action impressionnantes, et surtout j’étais content d’enfin voir le Stockholm des années 70, que j’avais tant imaginé à la lecture des romans.
⌾⌾⌾
Si jamais je suis parvenu à vous donner envie de lire ces polars, je précise qu’il est vraiment préférable de les lire dans l’ordre, c’est-à-dire en commençant par Roseanna. Enfin, si possible, lisez plutôt les nouvelles traductions de Michel Deutsch parues chez Rivages Noir entre 2008 et 2010 que celles de 10/18, qui étaient traduites depuis l’anglais.
3. Xérophytes
Pour boucler la boucle : samedi dernier, mon fils voulait aller à la galerie de paléontologie du Muséum d’histoire naturelle. C’était hélas complet pour la journée quand nous sommes arrivés. Faisant contre mauvaise fortune, bon cœur, nous sommes allés visiter la serre tropicale voisine, et c’était passionnant.

[Serre tropicale du jardin des plantes de Paris]
Nous avons vu des bananiers et des caféiers et de la vanille, et découvert l’existence des figuiers étrangleurs, mais c’est surtout la longue galerie consacrée aux plantes des milieux arides (les xérophytes) qui a retenu notre attention.
Je connaissais vaguement certaines des stratégies déployées par les végétaux pour survivre dans le désert, mais j’étais loin de me douter de leur variété :
- avoir des épines au lieu de feuilles : « Les épines sèches ne perdent pas d'eau évaporation quand il fait chaud, les feuilles oui. De plus, certains cactus sont couverts d'un réseau dense d'épines qui les protège des rayons ardents du soleil. »
- la succulence, qui consiste à faire des réserves d’eau dans des tissus spécialisés (comme les cactus)
- avoir des racines extrêmement longues et pivotantes, comme le mesquite
- l'allélopathie, qui consiste à empêcher d’autres plantes de pousser à proximité — le créosotier, par exemple, « libère des toxines qui empêchent d'autres plantes de pousser et donc d'utiliser l'eau et les nutriments dont il a besoin » (c’est la stratégie des gens qui fument juste avant de prendre le RER A)
- la réduction du cycle de vie : les éphémères du désert « germent, poussent, fructifient et produisent leurs graines en quelques semaines » ; d’autres plantes restent dans le sol sous forme de bulbe en attendant la pluie pour faire pousser feuilles et fleurs.
- les plantes reviviscentes, comme les roses de Jéricho, « se rétractent en boule et sont entraînées par le vent. Réhydratées après les pluies, elles s’étalent à nouveau et peuvent disséminer leurs graines ».
Voilà en tout cas qui sera bien utile quand la moitié sud de la France sera devenue désertique.
⌾⌾⌾
(Qu’on se rassure, mon fils est allé voir les squelettes de dinosaures aujourd’hui avec sa mamie, on n’est pas des monstres)
⌾⌾⌾
Et ce sera tout pour cette semaine.
À bientôt, portez-vous bien.
M.
⌾⌾⌾
ABSOLUMENT TOUT paraît un mercredi sur deux, avec chaque fois trois trucs intéressants.
Pour recevoir les futures livraisons, n’hésitez pas à vous inscrire
Et si ça vous a plu et que vous en redemandez, abonnez-vous sur Patreon !