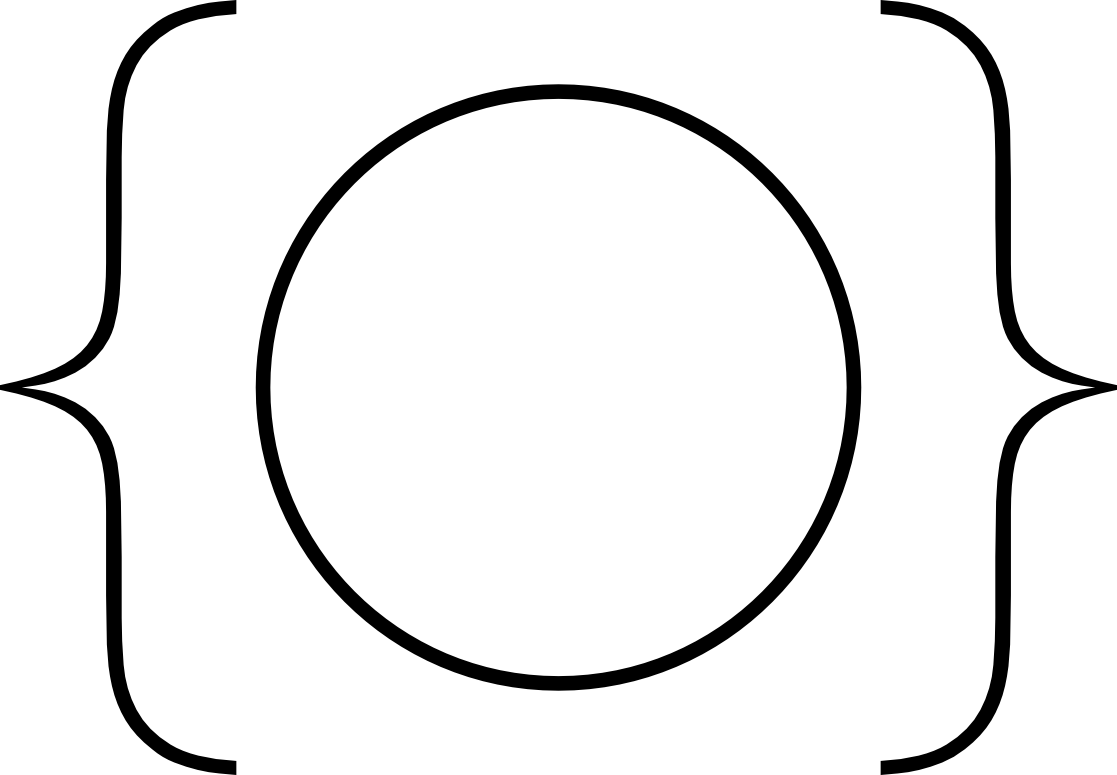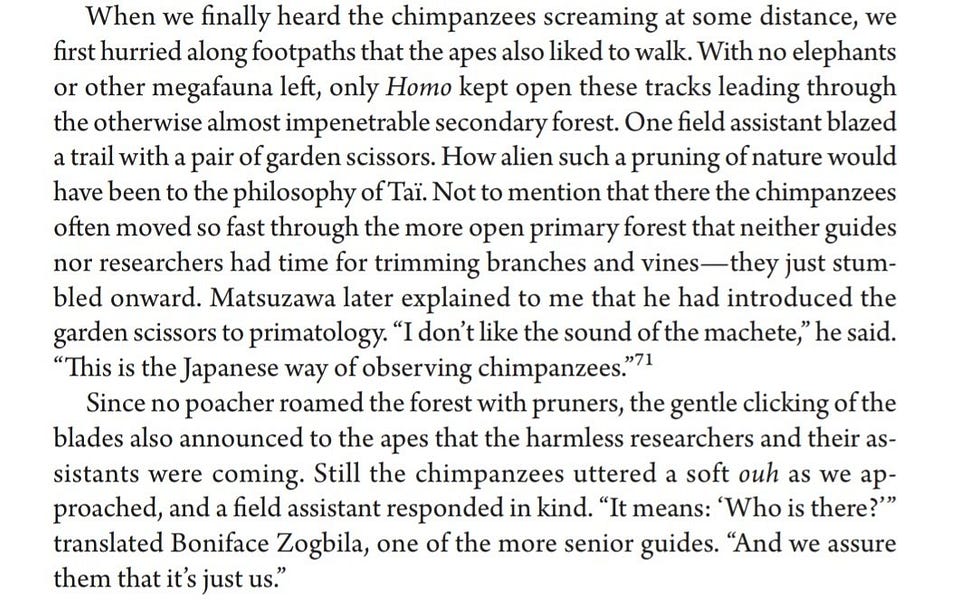Bonsoir tout le monde.
Cette semaine les contingences s'acharnent sur moi, alors je vous ai préparé une petite newsletter avec les trois plus beaux paragraphes lus ces derniers temps.
⌾⌾⌾
Absolument Tout est gratuit mais exige néanmoins un travail fort lourd, qui m’est d’autant plus pénible que je suis d’un naturel paresseux.
Pour soutenir la newsletter, abonnez-vous !
Vous m'aidez aussi énormément quand vous faites lire cette newsletter à celles et ceux qu'elle peut intéresser :
1. La disposition du lecteur
L'an dernier dans l'excellente revue Jef Klak, le sociologue Nicolas Marquis était interviewé à propos de son objet de recherche, les livres de développement personnel — qui n'intéressent que rarement les chercheurs en sciences sociales, sinon pour les balayer d'un revers de la main. Nicolas Marquis, lui, en parle avec intelligence et sans a priori, et c'est passionnant de le voir vraiment chercher, et non seulement confirmer ses a priori :
Mes premiers entretiens se sont assez mal passés, tant était omniprésente la question de la « désirabilité sociale » – le biais sociologique qui consiste à vouloir se présenter sous un jour favorable. Les lectrices et lecteurs sont très conscient·es de la mauvaise image du développement personnel, ils et elles cherchent en permanence soit à s’en défendre, soit à se distinguer du « mauvais » développement personnel qui serait la cause de sa réputation. J’ai donc demandé à des auteur·es un accès au courrier des lecteurs et lectrices qu’ils et elles recevaient. Trois ont accepté : Boris Cyrulnik, Thomas d’Ansembourg et Thierry Janssen. Ces lettres m’ont livré un récit de lecture du développement personnel dégagée de la méfiance que mon étude pouvait inspirer, ce qui m’a permis de l’envisager concrètement comme une expérience, comme une pratique qui induit une implication, un travail, que j’ai appelé la disposition du lecteur.
C’est très difficile pour un sociologue de décrire ce qui se passe quand on lit. La plupart de nos modes de collecte de données ne fonctionnent pas : si on interroge les gens après coup, on a du réchauffé. J’ai eu énormément de mal à trouver des ressources opératoires qui me permettent de décrire le travail fourni par les lectrices et lecteurs. Les travaux de Louise Rosenblatt ont été une révélation. Plutôt que de parler d’une interaction entre texte et lecteur ou lectrice, cette théoricienne de la littérature préfère parler d’une transaction, qu’elle nomme poème. Le poème est au texte ce que le concert est à la partition, un troisième terme. Quand un individu rencontre un texte, il y a quelque chose de plus qui se crée : la lecture particulière du texte, l’interprétation qu’il en fait. Prenons l’horoscope : c’est un bout de texte dont chacun·e sait très bien qu’il est généré de manière plus ou moins aléatoire ; si l’on veut vivre une expérience un tant soit peu satisfaisante à sa lecture, si l’on veut se laisser prendre au jeu, on doit y mettre du sien, en projetant sur ces quelques mots sa situation personnelle. Le poème, c’est cela. La partition, quelle qu’elle soit – ce peut être Madame Bovary, une notice Ikea ou un livre de développement personnel –, doit être « jouée » par le lecteur ou la lectrice. Mon objet d’analyse sera ainsi ce poème, c’est-à-dire non pas le texte, ni la lectrice ou le lecteur, mais ce qu’elle ou il fait du texte.
[« Demande-toi ce que tu peux faire pour t'en sortir. »]
(je vous recommande aussi de guetter les petites perfidies sur le Comité invisible)
2. L'âge de glace
J'ai proprement été ahuri à la lecture de ce paragraphe du livre Our biggest experiment, repéré par Russell Davies — c'est la première fois que je lis une explication aussi glaçante (hum) à la mini ère glacière qui fit, notamment, geler le vin sur la table de Louis XIV :
Comme le rappellent M. Maslin et Simon Lewis dans leur livre The Human Planet à propos de l’Anthropocène (l’ère géologique caractérisée par l’impact des humains), on constate une baisse sensible du carbone dans l’atmosphère au début du XVIIe siècle. Maslin et Lewis en voient la cause dans la colonisation des Amériques à peu près un siècle plus tôt, ou plus exactement dans la mort de 50 millions d’indigènes. Les morts ne cultivent pas leurs champs, et les terres abandonnées redevinrent des forêts, qui absorbèrent suffisamment de dioxyde de carbone pour qu’on le remarque dans les bulles d’air préservées dans les calottes glaciaires des pôles. Ce renversement fut bref. Les colons européens se mirent bientôt à l’agriculture, sans parler des mines de charbon, de l’invention du kérosène, de la création de chemins de fer, d’autoroutes, d’oléoducs et de gazoducs. Néanmoins, cette baisse temporaire des niveaux de dioxyde de carbone pourrait bien avoir joué un rôle dans la “petite ère glaciaire”, une série de vagues de froid allant entre 1350 et 1850, à peu près. Cette petite période glaciaire avait certainement de multiples causes (les poussières émises par des volcans qui masquaient la lumière du soleil, par exemple), mais la repousse causée par la colonisation des Amériques pourrait bien avoir été l’une d’elles ; les actions humains qui se combinèrent à celles d’autres composantes de la nature, tout comme aujourd’hui. La petite ère glaciaire n’était pas assez froide pour être une véritable ère glaciaire, mais il faisait tout de même froid. Le côté folklorique de l’affaire inclut des foires au gel, des spectacles de marionettes, des bœufs rôtis, et des enfants jouant à la balle sur des rivières glacées. On raconte que des oiseaux gelés tombaient du ciel, qu’Henry VIII allait d’un palais à l’autre en traîneau, que les New-yorkais marchaient de Manhattan à Staten Island, et même qu’on fit traverser la Tamise à un éléphant. C’est l’une des raisons pour lesquelles les violons Stradivarius violins sont si réputés ; les arbres de cette époque mettaient plus longtemps à grandir dans le froid, ce qui donnait un bois plus dense et donc un son d’une qualité particulière. Le côté sombre de cette petite ère glacière était que les gens mourraient de froid.
(Bon, pour les Stradivarius, je viens d'entendre que c'était une histoire de traitement anti-parasite du bois, donc le mystère reste entier)
3. Coexistence pacifique
Pour finir, j'ai adoré cette page, repérée par @Kum0kun et aimablement transmise par l'irremplaçable @temptoetiam :
Quand nous avons enfin entendu les cris des chimpanzés dans le lointain, nous avons emprunté les pistes sur lesquelles les singes aiment aussi marcher. Faute d’éléphants ou d’autres mégafaune, seuls les Homo entretiennent ces pistes, qui conduisent vers une forêt secondaire qui serait impénétrable sans elles. Un assistant de recherche ouvrit une piste avec un sécateur. Un tel élagage était fort étranger à la philosophie du parc de Taï. Sans parler du fait que les chimpanzés se déplaçaient souvent si rapidement dans la forêt primaire, moins dense, que ni les guides ni les chercheurs n’avaient le temps de tailler les branches ou les lianes : ils se contentaient de suivre en trébuchant. Matsuzawa m’expliqua plus tard que c’était lui qui avait introduit le sécateur dans la primatologie. “Je n’aime pas le bruit de la machette”, disait-il. “Voilà la manière japonaise d’observer les chimpanzés.”
Puisqu’aucun braconnier n’utilisait de sécateur pour se déplacer dans la forêt, le doux cliquetis des lames servait aussi à annoncer aux singes l’arrivée de chercheurs inoffensifs et de leurs assistants. Pourtant, les chimpanzés émirent un petit “ouh” à notre approche, et un assistant répondit de la même façon. “Ça veut dire : "Qui va là ?"”, traduisit Boniface Zogbila, un des guides les plus expérimentés. “Et nous leur répondons que ce n’est que nous.”
[Chimpanzee Culture Wars :Rethinking Human Nature alongside Japanese, European, and American Cultural Primatologists]
⌾⌾⌾
Et ce sera tout pour cette fois.
Portez-vous bien, rendez le monde un peu moins laid et les gens un peu moins tristes, sauf quand c'est mérité évidemment.
M.